Articles récents \ France \ Sport Les femmes dans le sport de l’antiquité jusqu’au 19ème siècle
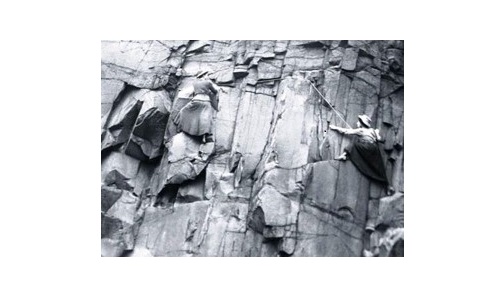
A Athènes, les femmes étaient interdites de stade sous peine de condamnation à mort, puisque pour y accéder il fallait être un homme, grec et libre. Seules les jeunes filles vierges étaient autorisées à assister aux Jeux Olympiques, les hommes y concourant nus. A Sparte, le sport y était encouragé, une Spartiate musclée et en bonne santé engendrera des “fils puissants et de futurs guerriers”. La jeune Spartiate s’entraînait munie d’une toge laissant apparaître le sein droit.
Les femmes concouraient entre elles, le sport n’étant pas mixte. Les jeunes filles non mariées étaient autorisées à prendre part aux Jeux Héréens, en l’honneur de la déesse du mariage, Héra. Ces compétitions avaient lieu tous les 4 ans dans le même stade que celui des hommes qui pouvaient s’adonner à d’autres sports en l’honneur de Zeus. Elles étaient limitées à une seule épreuve, celle de la course de 160 mètres déclinée en 3 temps.
Quelques exploits sportifs ont été relevés sous l’époque gréco-romaine dans d’autres compétitions. En 1500 avant notre ère, les cavalières de taureaux de Crète ont défié courageusement la mort, puis en l’an 1000, Atalanta bat Pelus à la lutte. En 440, l’athlète, Kallipateira, fera scandale en s’infiltrant, déguisée en homme, dans un stade où elle prendra part à une course. En 369, la Princesse Cyniska de Sparte devient la 1ère championne olympique de course de chars. Le Romain et historien, Tacite, rapporte dans ses écrits que certaines gladiatrices étaient attirées “par la gloire, la cruauté et le danger. En 320, aux Jeux de Rome, elles ont participé au lancer de poids, de disque, de saut, de courses et de javelot. Les aristocrates romaines avaient le droit d’assister à des tournois masculins.
Au Moyen-âge, les jeux sont tolérés par l’Eglise. On y joue au jeu de Paume (ancêtre du tennis), à la pelote basque, le jeu de soule, la quille, … Néanmoins, certaines pratiques n’étaient réservées qu’aux hommes car celles-ci s’appuyaient sur de la violence physique comme les tournois entre chevaliers. Les compétitions comme l’équitation, le tir à l’arc ou la lutte faisaient référence à un esprit belliqueux. Entraînement sportif et entrainement guerrier se confondaient.
Les chevaleresses n’étaient pas autorisées à participer aux tournois qui permettaient de mesurer leur courage à leurs homologues masculins. Elles n’avaient pas le droit de pratiquer de sport physique sauf pour la Noble qui chassait à la fauconnerie ou s’adonnait à l’équitation où elles montaient en amazone, de peur de rompre leur hymen si elles étaient à califourchon. Leur corps est considéré comme fragile et leur caractère peureux. En 1424, il est rapporté que Margot la Hennuyère avait battu ses adversaires masculins au jeu de Paume. « Margot joue très puissamment, très malicieusement et très habilement, et peu venaient d’hommes à qui elle ne gagnât ».
Il faudra attendre le 19ème s, pour que le sport devienne synonyme d’émancipation et de liberté dans une société qui se modernise et où les femmes revendiquent davantage leurs droits.
En 1805, Sophie Armant s’envole seule dans une montgolfière. En 1808, Marie Paradis devient la 1ère femme à avoir atteint le Mont-Blanc, habillée en robe. Le sport devient obligatoire à l’école publique pour que les garçons exercent des métiers physiques et que les filles résistent mieux aux tâches ménagères et autres métiers réservés aux femmes. Le sport est encouragé dans la sphère privée afin de donner aux hommes républicains des compagnes républicaines. La Noble s’adonne à l’escrime, au tennis, à l’alpinisme, à l’équitation alors que la Bourgeoise, pratiquera la natation et la gymnastique. L’ouvrière préféra le foot ou la course à pied.
Les hommes n’apprécient guère que les femmes empiètent sur le terrain de la compétition. On les met en garde car le sport en excès n’est pas recommandé pour les femmes. Il existe la possibilité de chute de la matrice, une augmentation du volume des jambes et de la pousse des poils sur la poitrine. Les cuisses découvertes, peuvent troubler les hommes pouvait-on lire dans les journaux.
Les femmes s’en moquent et, au contraire, elles expérimentent des sports de plus en plus physiques et nécessitant de la stratégie et de l’endurance comme le triathlon, le marathon, la course automobile, le cyclisme, le ski, l’aviation ou la moto. Elles occupent l’espace public jusqu’à présent, réservé à la gent masculine. Le corps se libère avec le sport. Le corset disparait et la jupe se raccourcit. Le Bloomer, sorte de culotte bouffante surmontée d’une jupe, est utilisé pour faire du vélo. Le docteur féministe, Léon Petit, lors d’une conférence s’exclamera : La culotte, emblème de l’égalité avec l’homme, la culotte ; symbole de la force et du pouvoir, la culotte depuis si longtemps désirée et enfin conquise ! Ah ! Messieurs, c’est un coup terrible porté à notre prestige ! La femme nous a pris la culotte, et il faut bien reconnaître qu’elle la porte mieux que nous !
Grâce au développement de la photographie et aux premiers films, le XXème s s’ouvre sur une ère sportive plus réglementée, médiatisée et populaire. Les fédérations sportives se créent avec celles pour les hommes d’un côté et celles pour les femmes de l’autre. Les 1er Jeux Olympiques font leur apparition avec, en arrière-plan, la lutte pour l’égalité en matière de sport et de droits qu’Alice Milliat, symbolisera encore un siècle après.
Laurence Dionigi 50-50 Magazine





