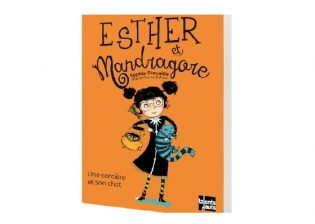Anne Cécile Robert est directrice adjointe du Monde diplomatique, enseignante et essayiste. Face aux bouleversements du monde et aux risques d’une troisième guerre mondiale, cette spécialiste des institutions européennes et internationales, comme l’ONU, qui a écrit plusieurs livres, nous rappelle dans cet entretien les valeurs pacifistes et humanistes qui constituent sa grille de lecture du monde, son engagement pour la réhabilitation de la paix et sa foi dans le pouvoir de la société civile.
Dans les conflits actuels ce sont des gouvernants hommes qui décident unilatéralement d’user de la force plutôt que de la diplomatie multilatérale. Pour ne citer que ceux à la Une de l’actualité : Poutine, Trump ou Nethanyahu n’ont que faire du droit international et montrent leurs biceps. N’y a-t-il pas un lien évident entre pouvoir, violence et masculinité ?
Je me pose pas la question en ces termes, parce que lorsque j’écoute Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, j’entends un homme qui défend à fond les valeurs de paix. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, aussi. Parallèlement, des femmes, dont certaines sont ministres aujourd’hui, ne défendent pas du tout des valeurs pacifistes et humanistes. La question est celle du pouvoir et de la conception qu’on a du pouvoir.
Même dans les organisations de type progressiste, le pouvoir est souvent conçu de la même manière, c’est-à-dire vertical, unilatéral, parfois appuyé sur la coercition et la violence. Ce qui fait que quelque soit la personne qui l’exerce, elle l’exerce de la même manière . C’est à cela qu’il faut réfléchir. J’aime bien cette phrase de Michel Foucault : «Le pouvoir ne se prend pas, il s’exerce».
La réflexion sur l’exercice du pouvoir reste très limitée. Qu’est-ce que c’est qu’un exercice collectif du pouvoir ? Qu’est-ce qu’un exercice partagé du pouvoir dans lequel chacun pourrait se reconnaître et qui profiterait à tous ? Je ne dis pas que c’est simple, mais je pense que ça s’éduque, ça se réfléchit.
Nos sociétés éduquent très peu au collectif et favorisent en permanence les réflexes “individualistes”, renforcés par l’usage des réseaux sociaux, le narcissisme, etc. Il y a une bataille culturelle à mener pour revaloriser le collectif, les notions collectives, de responsabilité envers autrui. On est beaucoup dans des logiques de droit et très peu dans des logiques de devoir.
L’une des caractéristiques de l’idéal républicain français sous la Troisième République, était que la logique des droits accompagnait la logique des devoirs. Et que plus vous aviez de pouvoir, plus vous aviez de devoirs. Cette notion des devoirs envers les autres, envers la collectivité, s’est amenuisée aujourd’hui. Elle était beaucoup plus puissante, il y a quelques décennies, dans les associations laïques, les associations communistes, les mouvements humanitaires, mais une bataille culturelle a été menée et a malheureusement favorisé une sorte de transformation de l’être humain en son propre produit, au détriment de ce qui le relie aux autres. Sans doute aussi parce que laisser le champ libre aux logiques verticales, est peut-être plus facile. Il faut donc réhabiliter la collectivité, l’écoute.
Oui justement. Les femmes ont davantage été éduquées avec ces valeurs du collectif, de l’attention à l’autre. Et par exemple, on sait que lorsque des femmes participent aux négociations pour la paix, elles sont plus solides et plus durables. Ne pensez-vous pas que si il y avait un peu plus que les 10% actuels de chefs d’État et de gouvernement femmes, c’est-à-dire si on avait une société plus mixte au pouvoir, ce serait l’ouverture vers cet autre mode de gouvernance dont vous parlez ?
Là encore, on retrouve l’enjeu des valeurs et qui les portent. Le fait qu’il y ait si peu de femmes est un problème en soi et c’est un problème parce que c’est le résultat d’une discrimination. Or, il y a la question des discriminations envers les femmes mais aussi, comme nous l’évoquions tout à l’heure, celles envers les pays du Sud, envers les classes sociales défavorisées, envers celles/ceux qui n’ont pas les outils culturels. Le constat selon lequel quand il y a plus de femmes aux tables de négociation, la paix est plus solide, ce n’est pas parce qu’elles sont nées femmes mais le résultat de mécanismes sociaux. C’est ce sur quoi il faut travailler : créer des espaces où il y a moins de discriminations, plus d’ouverture, plus de réceptivité à des modèles, des rapports sociaux différents.
J’ai travaillé à une époque sur les sociétés africaines traditionnelles, il y avait culturellement, et jusqu’à présent, une mise en avant du collectif, des valeurs sociales par opposition aux valeurs individualistes, et ce, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes. Je pense qu’on a besoin de plus de ces valeurs africaines, on a besoin d’arbres à palabres, on a besoin de toutes ces choses que les sociétés africaines connaissent, dont Nelson Mandela parlait beaucoup, Kofi Annan également. C’est ce type de diversité qui est intéressant, c’est la diversité sociale, culturelle, intellectuelle qui nous manque aujourd’hui face à un modèle unique qui étouffe tout et qui, de plus, a trouvé ses limites aujourd’hui. Il faut qu’on ait des modèles de transmission et des modèles culturels et éducatifs qui favorisent la diversité des sensibilités, des appréhensions, quel que soit le sexe, sans assignation. Je suis convaincue qu’il faut vraiment arriver à universaliser la manière de poser les problèmes afin que personne ne se sente obligé d’être porte-parole de quelque chose s’il n’en a pas envie.
Un mot de conclusion ?
Ma conclusion, c’est qu’il faut que tou·tes les citoyen·nes, où qu’ils et elles soient, se mobilisent, parce que rien ne se fera, si on attend tout de celles/ceux qui nous dirigent. Que chacun·e prenne sa part pour essayer de changer le climat intellectuel et culturel actuel, qui est un climat d’affrontement, de guerre civile, de guerre mondiale. Il faut vraiment combattre ça. D’autant plus que cet état d’esprit guerrier peut être présent chez certains dirigeants, mais qu’il est loin d’être dominant dans la société.
Propos recueillis par Jocelyne Adriant-Mebtoul 50-50 Magazine